|
David Albahari
La langue, c’est l’Histoire, et l’histoire la géographie
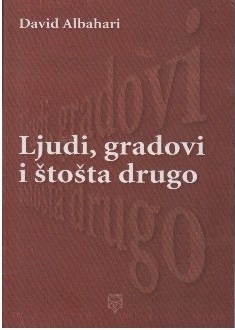
1
Le poète israélien Yehouda Amihaï dit dans un poème que les hommes utilisent toujours les guerres pour dater un fait ou un souvenir et que personne, en pareilles circonstances, ne mentionne la paix. Pour situer un événement, tout le monde dira, par exemple, qu’il a eu lieu avant la Seconde Guerre mondiale ou après la Guerre des six jours, et personne qu’il s’est déroulé avant la paix, disons, de 1967 ou 2002. Une autre observation s’impose : les guerres se voient toujours attribuer un nom, parfois même un surnom, et la paix, bien souvent, n’en porte aucun. En d’autres termes, il faut se rappeler les guerres alors que nous pouvons tranquillement oublier la paix. La vie s’écoule d’une guerre à la suivante, et non d’une paix à l’autre.
Quelque part ici se dissimule le pourquoi de l’absence de l’Histoire dans les livres que j’ai publiés jusqu’au début des années 1990. Je suis né après la Seconde Guerre mondiale, et celle-ci, même si j’en concevais toute l’effroyable ampleur (et notamment l’horreur de l’Holocauste), ne présentait aucun critère à mes yeux. Bien au contraire, comme je vivais dans un pays communiste qui glorifiait la part qu’il y avait prise, cette guerre s’était muée en un symbole qu’écrivain, je me suis efforcé d’éviter. La thématique guerrière appartenait pour moi à la précédente génération d’écrivains, à ceux qui avaient fait leurs les dogmes du réalisme socialiste et l’idéologie communiste. Pour qui, comme moi, avait grandi dans le monde de la culture rock et qui, écrivain, s’était formé dans le cadre du postmodernisme, l’Histoire, en vérité, ne représentait rien. À l’instar de Fukuyama, je croyais effectivement qu’elle avait pris fin. Je ne pouvais présumer qu’il lui fallait tout simplement débuter.
La désintégration de la Yougoslavie, doublée d’une guerre livrée sur plusieurs fronts, a introduit l’Histoire dans ma prose. Auparavant, je m’en étais parfois raillé – dans certaines nouvelles telle « La Grande Révolte du camp de Schtulen » qui figure dans le recueil Description de la mort [Opis smrti] – mais au milieu des années 1990, à partir du roman L’Homme de neige [Snežni čovek], le rire moqueur s’est éteint. L’Appât [Mamac], Ténèbres [Mrak], Goetz et Meyer [Gec i Majer] reflètent, dirais-je, l’impuissance et la terreur que j’ai ressenties face à la guerre. Ces romans sont écrits pour exprimer le désespoir à voir que l’homme n’est qu’un fétu de paille balloté aux quatre vents de l’Histoire et qu’il a beau faire, le cours de celle-ci ne saurait être modifié.
Il se peut que ma prose ne se serait pas à ce point ouverte aux thèmes historiques si j’étais resté à Belgrade. Tout comme je l’avais fait au début des années 1990 quand ont éclaté les premières querelles en ex-Yougoslavie, j’aurais délibérément fermé les yeux sur la réalité car c’était là l’une des tactiques de survie. Partir au Canada a néanmoins rendu cette tactique inutile, autrement dit la réalité de la guerre en ex-Yougoslavie est devenue incontestable, que l’on ait les yeux fermés ou non. L’absurdité de ma situation – vivre en paix et en toute quiétude mais, en mon for intérieur et en permanence, dans la guerre – fut fort heureusement pour moi une source d’inspiration et non de destruction. J’écrivais pour tirer, pour moi-même, la réalité au clair, et si la colère me prenait, c’est mon texte que je détruisais et non moi. D’où la forme du roman composé d’un seul paragraphe – à dire vrai, il n’y avait plus de temps pour rien sinon consigner le flot de mots qui fuyaient, si je peux m’exprimer ainsi, tout ce qui pouvait ressembler à l’ordre et, aussi, à toute forme ordonnée quelle qu’elle fût. Le chaos apparent de l’Histoire ne pouvait s’exprimer que par le chaos apparent de la langue, tout comme dans l’Histoire cette apparence dissimulait la logique de l’ordre dans lequel survenaient les événements, et dans ma prose, sous le chaos apparent de la forme, se cachaient des schémas réguliers de pensée, de langue, et de rythme impeccablement respectueux de l’ordre.
2
Venir au Canada a pesé sur mon rapport à la géographie. Ce qui ne se serait sans doute pas produit si j’étais arrivé dans la partie plate du Canada, mais débarquer à Calgary m’a exposé à l’influence de montagnes qui, auparavant, ne représentaient rien pour moi. J’ai grandi dans la plaine, sur la rive du puissant mais pourtant fleuve de plaine qu’est le Danube, et connaître les montagnes Rocheuses a pris pour moi la dimension d’une découverte géographique. Autant le Danube domine ma prose antérieure aux années 1990, autant les montagnes Rocheuses dominent celle postérieure à mon venue au Canada. Ce qui se voit en particulier dans le roman Globe-trotter [Svetski putnik] dont l’action se déroule à Banff, un lieu de légende des Rocheuses où j’ai habité lors de mon premier séjour au Canada, au cours de l’été 1994.
En réalité, je m’aperçois aujourd’hui que ma source véritable d’inspiration aura été une incessante mise en parallèle de la géographie dans laquelle je vis désormais et de celle où je vivais auparavant. Ce qui vaut aussi pour l’Histoire. L’absence ou, plus exactement, la modicité de l’Histoire dans ces contrées m’incitait constamment à la comparer à l’Histoire nettement plus longue des Balkans et de l’Europe, de sorte que j’ai trouvé l’inspiration – ou c’est elle qui m’a trouvé ? – dans le jeu qu’elles se livrent, dans la « supériorité » manifeste de celle européenne sur l’américaine. Ce sont là, bien évidemment, des simplifications, les rapports réels sont d’une plus grande complexité, mais les simplifications sont parfois indispensables pour permettre à une œuvre artistique de fonctionner. L’essentiel est que l’authenticité et l’exactitude soient respectées, qu’il s’agisse de l’Histoire ou de la géographie.
Dans le monde de l’enfance, à la différence du monde des adultes, l’authenticité ne revêt pas une telle importance, géographie et Histoire ont une valeur avant tout mythique ; il était donc possible de leur attribuer ce qui, à cet âge, nous correspondait le mieux. En outre, que les « faits » géographiques ou historiques fussent puisés dans des sources réelles (atlas de géographie ou manuel d’Histoire) ou le produit de l’imagination (les romans de Jules Verne ou de Karl May, par exemple) n’avait aucune importance. Dans la conscience d’un enfant, leur égalité est parfaite, et on ignore qui exercera l’influence la plus forte. Disons qu’en ce qui me concerne, le monde des profondeurs marines existe encore et toujours comme le reflet du monde de Vingt Mille Lieues sous les mers, malgré toutes les découvertes que la science a faites à ce propos. Évidemment, que l’un soit authentique et l’autre né de l’imagination ne constitue plus un dilemme – je sais quoi est quoi – mais aux moments où la possibilité m’est offerte d’opérer un choix, le monde imaginaire s’adjuge un avantage absolu.
Cela signifie-t-il, à vrai dire, que je vis dans deux mondes parallèles ? Dans un certain sens, oui, mais pas au sens littéral car ce serait là un symptôme de schizophrénie. Une réponse plus exacte serait que je vis dans le monde réel mais que, de temps à autre, je projette les coordonnées de ce monde sur la carte du monde de l’enfance, créant ainsi entre eux un jeu qui est parfois source d’inspiration, parfois de réconfort, et parfois seulement d’amusement. Je justifie l’existence de cette carte du monde de l’enfance par le besoin que je ressens de m’exclure de la réalité, de « n’être pas ». Au fil des années, ce besoin de souffler gagne en importance, surtout que je suis ensuite confronté à l’image plus en aspérités du monde réel, de cet « aujourd’hui » ou de ce « maintenant », le seul en vérité dans lequel nous vivons.
3
Indéniable est le fait que nous avons découvert le monde par le biais des livres, en partie du cinéma, et que les générations actuelles le découvrent presque exclusivement par celui des médias visuels, télévision et internet surtout. Nous avons fait la connaissance du monde en tant que texte, que description ; les nouvelles générations en tant qu’images, que sons. La différence entre le monde décrit et celui vu en images est bien sûr énorme : dans le premier cas, la description que nous livre quelqu’un d’autre, et que nous lisons, n’est qu’un stimulant de l’imagination, ce qui signifie que chacun, à sa façon, donnera forme à la représentation du monde que tous avons lue ; dans l’autre cas, l’image vue est définitive ou, à tout le moins, plus définitive que celle décrite et lue. Je ne saurais dire si cette différence démontre quoi que ce soit hormis mon inclination à accorder aux mots une confiance plus grande qu’aux images, mais je considère qu’avec le temps, cette différence deviendra cruciale dans l’interprétation des différentes manières dont les membres de différentes générations auront appréhendé la structure du monde.
4
Ma fascination pour l’Histoire – en tant que thème d’écriture, naturellement – s’est éteinte et désormais, à nouveau, mon intérêt se porte sur l’histoire racontée, autrement sur l’acte de narration. Ce qui ne signifie pas que l’Histoire a pris fin, il me faut l’admettre à contrecœur, mais que pendant la rédaction de mes romans historiques j’ai appris à contrôler son influence. Au désespoir qui m’a poussé à écrire L’Homme de neige et L’Appât s’est substitué un respect qui sous-entend nettement plus de sérénité et, si je peux m’exprimer ainsi, d’équité dans notre relation. L’Histoire sait que je lui suis assujetti, et je sais que je peux la maîtriser, en apparence du moins, et ainsi la transformer en histoire.
5
Contrairement à l’Histoire, la géographie nous rend les choses à première vue plus faciles. Elle ne nous surplombe pas tel un nuage menaçant, elle ne fait rien qui échapperait à notre volonté. C’est nous qui la choisissons, et dans la réalité et dans les livres. Les dangers qu’elle suggère dans les livres nous donnent un doux frisson. Un frisson qui se perçoit le mieux quand on est jeune : je me souviens d’avoir tremblé en lisant des romans d’aventures où la géographie, réelle ou fictive, était ressentie comme une présence funeste qui permettait aux Parques d’entrelacer les fils de diverses destinées humaines. Le temps passant, dans les livres que je lisais cette géographie-là a cédé la place à une géographie urbaine – la Chicago de Saul Bellow, par exemple, ou l’universelle Stetl d’Isaak Bashevis Singer ou la Novi Sad d’Aleksandar Tišma. Entre-temps, le frisson a disparu, mais la fascination pour la géographie demeure. Ce qui peut sans doute s’expliquer par la présence tangible de la géographie – exception faite, il va de soi, de celle de la science-fiction – alors que l’Histoire n’existe sous aucune forme matérielle. Les traces que cette dernière laisse sont en fait celles de son action sur la géographie, et on pourrait dire qu’elle est une sorte de parasite qui trouve sa subsistance dans la géographie. Nous regardons la géographie et disons : voilà l’œuvre de l’Histoire, tout en sachant que l’Histoire n’existe pas. Nous sacrifions la géographie et courtisons l’Histoire. De la géographie nous créons l’Histoire dont, ensuite, nous proclamons la permanence. L’Histoire, disons-nous, nous enseigne la vie, alors qu’il nous faudrait témoigner notre gratitude à la géographie. Une montagne représente la permanence, une guerre est une ombre qui passe. Mais nous gravons l’ombre dans notre mémoire et inscrivons la montagne dans un atlas, qu’il nous arrive rarement d’ouvrir, et nous portons toute notre attention aux ombres et, faute d’ombres, nous en faisons. Nous sommes amoureux de la géographie, mais l’élue de notre vie est l’Histoire ; qu’elle soit absente, que nous vivions un répit historique, nous sommes prêts et désireux de nous abandonner à la géographie qui se languit de nous et se prépare déjà à nous voir partir sitôt qu’il nous semblera entendre les trompettes sonnant une nouvelle entrée en campagne de l’Histoire, quels qu’en soit le motif et le but.
6
Toutes ces interprétations sont peu ou prou celles, artificielles, d’un adulte. Ce que la lecture a apporté pendant l’enfance – ravissement, illusion, enchantement, mystère – ne saurait se répéter quand on avance en âge. Quel crédit, par exemple, accorder aujourd’hui à ce que je lis ? Suis-je réellement en mesure de percevoir l’enchantement, de m’abandonner à un livre qui, tapis volant, me transportera dans le monde des rêves ? Avec le temps, lire devient une routine, comme tout le reste dans la vie, et dénicher des livres qui forcent la conviction se révèle une tâche de plus en plus ardue. Ce qui explique la fébrilité avec laquelle les écrivains se jettent dans la quête d’épisodes historiques inconnus ou de toponymes géographiques exotiques. La géographie « ordinaire », l’Histoire « ordinaire » n’intéressent plus les lecteurs que nous sommes, il nous faut quelque chose d’original, de plus fort, qui fasse exception (et, du même coup, confirme d’autant mieux la règle). D’où l’aspiration à retrouver la lecture « vierge » qui était celle de l’enfance quand nous n’accordions foi qu’à l’histoire et rêvions ensuite d’elle sans réfléchir au message sous-jacent, sans nous livrer à son interprétation, et en refusant l’interprétation comme but ultime de la lecture. Dans le même temps, ceci explique mon penchant pour la poétique postmoderne, et donc cette pratique qui se méfie de l’interprétation (et de l’inspiration, faut-il ajouter) et conteste la validité de tout, y compris de la langue elle-même et, bien entendu, de l’histoire elle-même.
7
Il n’y a pas de littérature sans géographie ni Histoire. Même dépouillé à l’extrême, le monde de la prose est marqué par leur présence ou par un effort visant à les rendre absentes. Une pièce vide ou une scène de théâtre déserte est une forme de géographie, de même que la durée d’une œuvre constitue de fait son Histoire. Au demeurant, la langue elle-même est en soi l’Histoire. Une analyse linguistique déterminera toujours avec précision l’époque où un texte a été écrit car la langue ne peut s’évader du cadre historique qui est le sien. Faire un faux littéraire n’est possible qu’en remontant dans le temps : comment falsifier un livre qui paraîtra au siècle prochain ? Anticiper avec exactitude la façon et la vitesse auxquelles la langue évoluera ne se peut tout bonnement pas.
L’histoire, par ailleurs, c’est la géographie. Elle est le domaine ou la scène de théâtre sur laquelle la langue évolue. L’histoire confère à la langue sa force de conviction, elle confirme sa puissance créatrice. Du reste, c’est par la langue que le Seigneur construit la géographie, et ce, par une langue extérieure au temps, extérieure à l’Histoire. Et quand la présence de la géographie est totale, alors seulement le Seigneur va prendre du repos, et l’Histoire commence. Elle commence quand le Seigneur se couche et cède à la somnolence, à sa satisfaction d’avoir construit le cadre du monde futur. Quand il plonge dans le sommeil, l’Histoire transforme le monde futur en passé. Ce qui était jusque-là altérable et perpétuellement à même de changer devient immuable. En d’autres termes, la géographie se fait servante de l’Histoire. Par l’installation d’une nouvelle géographie, toute histoire est donc une tentative pour abuser l’Histoire, mais toute tentative de cet ordre est vaine. L’Histoire est toujours la plus forte.
In David Albahari, Ljudi, gradovi i štošta drugo [Les gens, les villes et bien d'autres choses], Novi Sad, Dnevnik, 2011, p. 86-93.
Date de publication : décembre 2015
Date de publication : décembre 2015
Date de publication : juillet 2014
> DOSSIER SPÉCIAL : la Grande Guerre
- See more at: http://serbica.u-bordeaux3.fr/index.php/revue/sous-la-loupe/164-revue/articles--critiques--essais/764-boris-lazic-les-ecrivains-de-la-grande-guerre#sthash.S0uYQ00L.dpuf
|